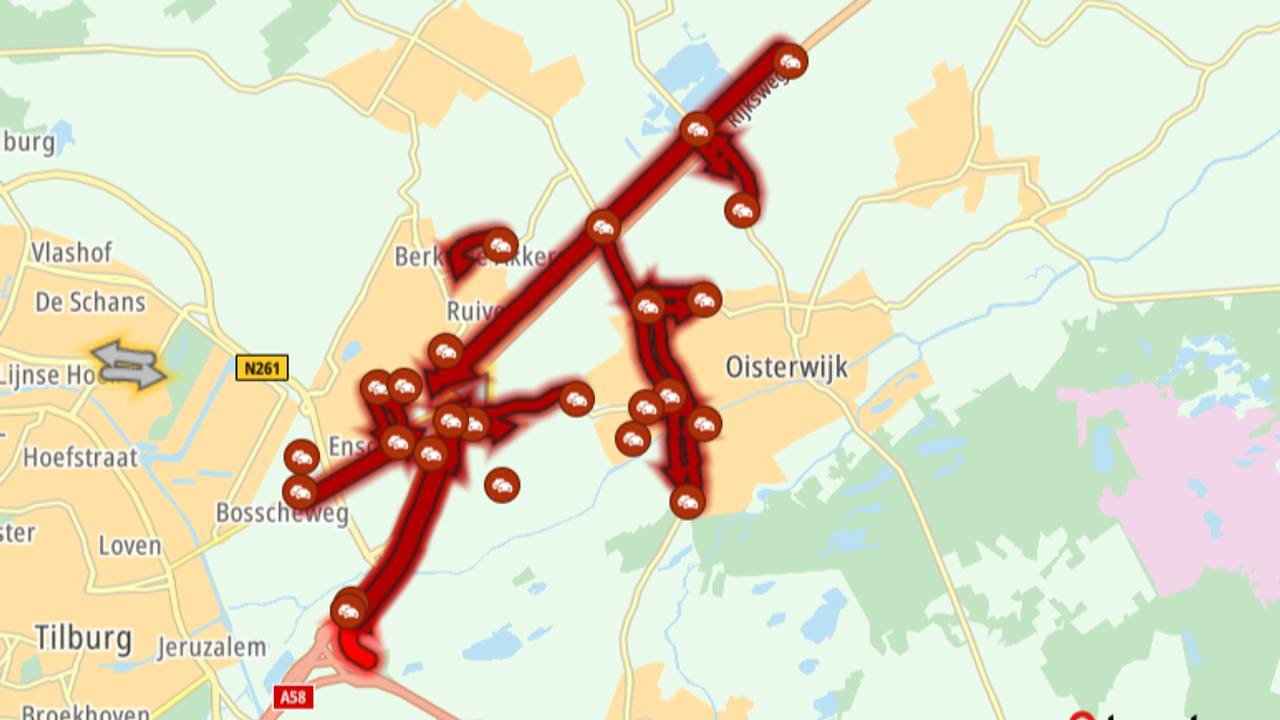Méditerranée, dans les 80 ans. L’eau de mer atteint une température de 30 degrés et l’acidité se situe à un pH de 7,7. C’est le pire scénario prédit par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, un organe consultatif scientifique des Nations Unies). De nombreuses espèces ne survivent pas au nouvel environnement, mais une seule y survit : la méduse. Cotylorhiza tuberculata, l’un des plus communs dans cette mer. Une équipe de l’Institut des sciences marines d’Andalousie (ICMAN, lié au CSIC, l’agence officielle de recherche scientifique espagnole), a soumis des spécimens de cette espèce à de telles conditions et analysé leur capacité d’adaptation. Angélica Enrique-Navarro, auteur principal de l’expérience, publié dans la revue PLOS ONEexplique que “la grande tolérance aux changements environnementaux dont témoignent les polypes de cette méduse permettra à l’espèce de s’acclimater progressivement sur le long terme, en s’adaptant aux conditions de température et d’acidification attendues”.
L’effet ne sera pas seulement une prolifération extraordinaire de ces méduses, une circonstance qui est déjà devenue monnaie courante. Le problème, c’est que cela va altérer l’écosystème. Jamileh Javidpour, professeur de biologie à l’Université du Danemark du Sud, estime qu’il est prévisible que “alors que nous constatons une augmentation des méduses, nous verrons également un changement dans les populations de prédateurs, en particulier dans les zones où l’abondance des proies communes pourrait être mise en danger en raison de un environnement changeant ». Javidpour est l’auteur d’une étude centrée sur les méduses publiée dans la revue Journal de recherche sur le plancton.
Ces épisodes de prolifération des méduses et sa généralisation dans les pires scénarios de changement climatique sont liés à des facteurs tels que l’exploitation halieutique disproportionnée et la présence excessive de nutriments inorganiques issus des activités humaines, en plus des changements de température et d’acidité de la mer. Ces circonstances affectent toutes les espèces, mais l’étude a montré que la Cotylorhiza tuberculata il est plus tolérant et montre une plus grande capacité d’adaptation, c’est pourquoi, selon le chercheur espagnol, il pourrait conduire à son expansion en tant qu’espèce plus opportuniste.
“Ces méduses sont parmi les plus résistantes”, explique Enrique-Navarro. “Ils habitent les océans depuis 500 millions d’années et se sont adaptés à de nombreux changements depuis lors. Sans la concurrence d’autres espèces marines, elles pourraient devenir prédominantes et altérer l’écosystème.
Pour cette capacité, ils ont développé deux compétences décisives. La première est qu’ils alternent reproduction sexuée et asexuée. Chez ces derniers, ils génèrent des polypes millimétriques qui s’ancrent au substrat marin et génèrent, par bourgeonnement (protubérances ou exaspéré de l’individu parent), des clones génétiquement identiques, qui donnent naissance à de petites méduses appelées éphyrae. “Si les conditions sont bonnes”, ajoute l’expert, “ils se reproduisent de façon exponentielle”.
La deuxième capacité fondamentale de ces invertébrés marins est leur symbiose avec des microalgues appelées zooxanthelles. Ceux-ci, en échange de la protection apportée par les méduses contre les prédateurs, atténuent les effets négatifs de l’incidence des rayons ultraviolets et de la réduction du pH pour leur survie.
Le spécialiste observe que d’autres études indiquent une troisième capacité pour la survie de l’espèce : un thermostat moléculaire qui indique les meilleures conditions de température pour la procréation.
L’expérience
Pour cette étude, l’équipe d’Enrique-Navarro a soumis des spécimens de Cotylorhiza tuberculata à trois scénarios : un avec la température moyenne normale de l’hiver actuel en Méditerranée (18 degrés Celsius), un autre avec 24 degrés, et le pire, qui aura lieu en 2100, lorsque la température de l’eau atteindra 30 degrés, si le tendances actuelles du changement climatique.
A ces conditions se sont ajoutés différents scénarios d’acidité dans l’eau. « La plupart des études menées sur les méduses, explique le chercheur, ne prenaient en compte que les conséquences de la température, et nous voulions voir quel était l’effet synergique des deux variables ».
Enrique-Navarro résume les résultats : “Ils indiquent que la reproduction asexuée des méduses reste la même et que, dans certains cas, avec des températures de 30 degrés et avec l’acidification prévue en 2100, elle était encore plus élevée”. Ce n’est qu’à terme que l’échauffement et l’acidification “ont affecté la phase de transition du polype à la méduse et la formation des éphyrules, générant des malformations et compromettant leur survie”. Mais dans la plupart des cas, ils ont pu résister aux conditions difficiles.
L’étude permet de comprendre plus précisément les phénomènes de prolifération des méduses et leur réponse biologique aux conditions climatiques, en plus de contribuer à établir ces communautés comme indicateurs biologiques des conditions environnementales de la mer et de permettre la mise en place de mesures.
L’effet de la prolifération des méduses est immédiat et direct, et pas seulement sur le fragile équilibre de l’écosystème marin. Comme le résume Gerhard Herndl, professeur au Département d’écologie fonctionnelle et évolutive de l’Université de Vienne, “les grandes proliférations de méduses bloquent les conductions des usines côtières d’énergie et de dessalement, interfèrent avec les opérations des navires et causent des dommages aux industries du tourisme”. , la pêche et l’aquaculture ». Herndl considère qu’il est important « de bien comprendre le rôle et l’impact de ces épisodes sur l’écosystème marin ».
L’une de ces études, dont il est co-auteur et laissé à l’intérieur Frontières en microbiologie, analyse ce qui se passe lorsque cet excès de méduses meurt, ce qui est de plus en plus courant. Selon l’étude, à la fin de leur cycle de vie, ils génèrent également une “croissance rapide de seulement quelques souches de bactéries marines opportunistes, qui, à leur tour, fourniront de la nourriture à d’autres animaux marins dans la colonne d’eau”. Il conclut: “Il existe de nombreuses espèces de méduses et d’autres organismes gélatineux dont la prolifération peut provoquer des changements temporaires dans le réseau trophique, et tous les écosystèmes où ils se produisent ne sont pas identiques et ne peuvent pas supporter les mêmes souches de bactéries.”

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/SA3B5S347EBY7TVKIJNT6RDRJM.jpg?fit=%2C&ssl=1)